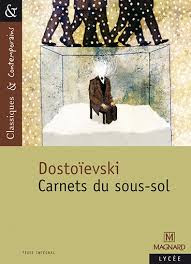Lecture du mercredi 12 février 2020.
N.B. : La première traduction que je donne est celle d’André Markowicz, publiée chez Actes Sud, 1992. La deuxième que je donne parfois est celle de la version de Feedbooks, gratuite à partir du site des bibliothèques municipales de la Ville de Paris.
La longueur des chapitres de Feedbooks est parfois beaucoup plus courte que celle d’Actes Sud mais la traduction n’en est pas moins intéressante.
« Le Sous-sol » (1863), ce dernier roman étant également connu sous les titres suivants : « Mémoires écrits dans un souterrain », « Les Carnets du sous-sol », « Manuscrit du souterrain ».
ATTENTION : Je n'ai pas copié-collé l'oeuvre entière mais seulement les passages qui m'intéressaient.
ATTENTION : Je n'ai pas copié-collé l'oeuvre entière mais seulement les passages qui m'intéressaient.
Chapitre 1
Note perso : de la velléité d’être méchant pour se sentir exister, être quelqu’un.
« Je suis un homme malade... Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. (…) Et il y a longtemps que je vis ainsi, une vingtaine d’années. J’ai quarante ans. »
« J’ai menti plus haut, en disant que j’étais un fonctionnaire méchant. J’ai menti par méchanceté. »
« En fait, je n’ai jamais pu devenir méchant. Je ressentais à chaque instant au fond de moi une foule, oui, une foule d’éléments les plus hostiles à la méchanceté. Je les sentais grouiller à l’intérieur, ces éléments hostiles. Je savais bien qu’ils y avaient grouillé toute ma vie et qu’ils ne demandaient qu’à jaillir au-dehors, mais je refusais, je refusais, oh oui, je refusais de les voir jaillir. Ils me martyrisaient jusqu’à la honte; ils en arrivaient à me donner des convulsions - et comme j’ai fini par en avoir assez, mais assez ! Tout doux, messieurs, n’auriez-vous pas l’idée que je bats ma coulpe devant vous - que tout se passe comme si je vous demandais pardon de je ne sais quoi?... Je suis sûr que oui... Bah, pensez ce que vous voulez - moi, je vous assure que ça m’est égal…
Non seulement je n’ai pas su devenir méchant, mais je n’ai rien su devenir du tout: ni méchant ni gentil, ni salaud, ni honnête - ni un héros ni un insecte. Maintenant que j’achève ma vie dans mon trou, je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu’inutile: car quoi, un homme intelligent ne peut rien devenir - il n’y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du XIX° siècle se doit - se trouve dans l’obligation morale - d’être une créature essentiellement sans caractère; un homme avec un caractère, un homme d’action, est une créature essentiellement limitée. C’est là une conviction vieille de quarante ans. Maintenant j’ai quarante ans - et quarante ans, c’est toute la vie: la vieillesse la plus crasse. Vivre plus de quarante ans, c’est indécent, c’est vil, c’est immoral. Qui donc vit plus de quarante ans? Répondez, sincèrement, la main sur le cœur ! Je vous dis, moi: les imbéciles, et les canailles. Je leur dirai en face, à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs, parfumés de benjoin! Je le dirai à la face du monde! J’ai bien le droit de le dire, je vivrai au moins jusqu’à soixante ans. Je survivrai jusqu’à soixante-dix! Et jusqu’à quatre-vingts!... Ouf, laissez-moi souffler. »
« On me dit que le climat de Petersbourg me fait du mal et qu’il est très coûteux de vivre à Petersbourg avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d’expérience, mieux que les béni-oui-oui. Eh bien, je reste à Petersbourg: je ne sortirai pas de Petersbourg! Si je ne sors pas, c’est que... Ah, mais ça n’a rigoureusement aucune importance, que je sorte ou que je ne sorte pas.
Mais bon: de quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir?
Réponse: de lui-même.
Et donc, je parlerai de moi. »
Chapitre 2
Note perso : de la jouissance de la conscience du désespoir. J’ai vécu tout ce qu’il décrit sauf son principal message à propos de la jouissance, précisément. Je n’ai jamais joui d’avoir uneconscience aigue de mon désespoir sous toutes les coutures : au contraire, j’en ai toujours été...désespérée. C’est une malédiction.
« Maintenant, messieurs, je veux vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n’ai même pas pu devenir un insecte. Je vous le dis avec solennité: j’ai voulu devenir un insecte à plusieurs reprises. Et, même là, je n’ai pas eu l’honneur. Je vous assure, messieurs: avoir une conscience trop développée, c’est une maladie, une maladie dans le plein sens du terme ».
« Et néanmoins, je reste fermement convaincu que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. J’insiste. Laissons cela aussi pour l’instant. Dites-moi une chose: pourquoi est-ce justement, comme par hasard, dans les mêmes minutes, oui, les minutes mêmes où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses “du beau et du sublime”, comme on disait jadis, qu’il m’arrivait non plus d’avoir conscience mais d’accomplir des actes si peu reluisants que... bref, en un mot, qui sont le lot de tous, mais que je faisais, moi, comme par hasard, dans les instants précis où je sentais le plus que je ne devais pas les faire? Plus je prenais conscience du bien, de tout ce “beau” et ce “sublime”, plus je m’engluais dans mon marais, et plus j’étais capable de m’y noyer complètement. Mais l’essentiel restait que ça ne semblait jamais fortuit - comme si c’était ce qu’il fallait. Comme si c’était là mon état naturel, et non ma maladie ou mon défaut, de sorte qu’à la fin j’ai perdu toute envie de combattre ce défaut. Et j’ai fini par faillir croire (peut-être l’ai-je cru vraiment) que c’était bien cela, mon état naturel. Mais d’abord, au début, que n’ai-je pas dû subir dans cette lutte! J’étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas, je cachais donc cela comme un secret. J’avais honte (peut-être ai-je honte jusqu’à ce jour); j’en arrivais à ressentir je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi, dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Petersbourg et que j’avais une conscience accrue d’avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté et, ce que j’avais fait étant irréparable, je me rongeais, secrètement, de l’intérieur, je me rongeais à toutes dents, me taraudais et me bouffais moi-même jusqu’à ce que l’amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur et puis une jouissance, franche et grave! Une jouissance, oui, une jouissance! J’insiste. J’en parle parce que j’ai toujours voulu en avoir le cœur net: les autres ressentent-ils ce genre de jouissance? Que je vous explique: cette jouissance-là provient d’une conscience trop claire de votre abaissement; du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade; et que c’est moche, et qu’il n’y a pas moyen de se sentir mieux; qu’il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre; que, même s’il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d’autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer; et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu’il est vrai, peut-être, que vous n’avez plus rien en quoi vous transformer. Surtout et à la fin des fins, cela se produit suivant les règles naturelles, fondamentales, de la conscience accrue et de l’inertie qui en découle directement, et donc, en conséquence, non seulement il n’y a plus moyen de se transformer, mais il n’y a, tout simplement, plus rien à faire. Vous arrivez, par exemple, à cela, avec votre conscience accrue: vous faîtes bien d’être une canaille - comme si c’était une consolation pour une canaille, d’avoir conscience qu’elle est vraiment une canaille. Pourtant, assez... Ça, pour parler, j’ai bien parlé, mais j’ai expliqué quoi?... Comment s’explique ce genre de jouissance? Si, si, je m’expliquerai! Je finirai par y arriver. C’est pour cela que je me suis mis à écrire...
Par exemple, j’ai un amour-propre effrayant. Je suis susceptible et rancunier comme un bossu ou comme un nain, et cependant, j’ai vécu des minutes où si j’avais reçu une gifle, j’aurais bien pu en être heureux. Je ne ris pas: sans doute aurais-je été capable de découvrir même là une sorte de jouissance - jouissance du désespoir, cela s’entend, mais c’est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants, surtout si l’on ne ressent que trop l’impasse où nous sommes tombés. Et là, cette gifle - comme elle vous écrabouille la conscience, de voir quelle crotte on vient de faire de vous. L’essentiel, quoi qu’on qu’en en dise, c’est quand même cela, que c’est moi le premier coupable de tout, et, le plus humiliant, c’est que je suis coupable sans péché, pour ainsi dire, selon les seules lois de la nature. Parce que, d’abord, je suis coupable d’être plus intelligent que tous ceux qui m’entourent. (Je me suis toujours senti plus intelligent que tous ceux qui m’entouraient, et quelquefois - me croirez-vous? - j’en ai même éprouvé des scrupules. Du moins, toute ma vie, ai-je regardé pour ainsi dire de biais, et me suis-je toujours montré incapable de regarder quiconque droit dans les yeux.) Parce que je suis coupable, enfin, du fait que même si j’étais doué d’une quelconque grandeur d’âme, je n’en éprouverais qu’une douleur plus grande à la conscience de son inutilité. Je crois que je ne saurais pas quoi faire avec ma grandeur d’âme : ni pardonner à mon offenseur, s’il m’a frappé en vertu des lois de la nature; ni oublier, parce que les lois de la nature sont ce qu’elles sont, mais l’humiliation aussi. Et même si j’avais voulu ne pas avoir la moindre grandeur d’âme, si j’avais désiré, au contraire, tirer vengeance de mon offenseur, j’aurais bien été incapable de le faire, parce que, sans doute, je n’aurais jamais pu me décider, et ça, même si j’en avais eu la possibilité. Pourquoi n’aurais-je pas pu me décider? Je veux dire deux mots sur le sujet. »
Autre traduction :
« Dites-moi : comment se pouvait-il faire que, juste aux heures (oui, juste à ces heures-là !) où je concevais le plus précisément toutes les délicatesses « du Beau et du Grand », comme on disait jadis, il m’arrivât, non plus de projeter, mais d’accomplir des actions si viles, si viles que… ? Plus j’approfondissais le Bien et « le Beau et le Grand », plus je m’enfonçais dans ma fange et plus j’étais tenté de m’y perdre tout à fait. Mais le point capital, c’est qu’il n’y avait dans mon cas rien d’apparemment anormal : il me semblait que c’était tout naturel. C’était un état de santé ordinaire, sans aucun élément morbifique. De sorte qu’à la fin j’ai cessé de lutter. J’ai failli croire (et peut-être l’ai-je cru en effet) que c’était là une destinée fatale. J’ai d’abord beaucoup souffert. Je croyais ma situation unique, et je cachais tous ces phénomènes intérieurs comme des secrets. J’en avais honte (n’en ai-je pas encore honte maintenant ?), mais je goûtais de secrètes délices, monstrueuses et viles, à songer en rentrant dans mon coin par une de ces sales nuits pétersbourgeoises, à songer, dis-je, que « aujourd’hui encore j’avais fait une action honteuse, et que « Oui, en plaisir ! oui, en plaisir ! J’y tiens. Je relate cette observation exprès pour savoir si d’autres ont connu ce singulier plaisir. Écoutez-moi : le plaisir consistait justement en une intense conscience de la dégradation, justement en ceci que je me sentais descendre au dernier degré de l’avilissement, et qu’il n’y avait plus d’issue, et que s’il m’était accordé encore assez de temps et de foi pour me transformer en un homme meilleur, assurément je n’en aurais pas voulu prendre la peine. L’eussé-je même voulu, je n’aurais pas fait le moindre effort pour y parvenir, car me transformer… en quoi ?… Mais assez !… Hé ! qu’est-ce que je dis là ! quel mystère voulais-je donc expliquer ?…
Je vais pourtant essayer de vous dire en quoi consistait ce délice. Je vais vous le dire, vous le dire par le menu, car c’est précisément pour cela que j’ai pris la plume…
J’ai beaucoup d’amour-propre. Je suis toujours en méfiance et je m’offense facilement, comme un bossu ou un nain. Eh bien, à certaines heures, n’importe quoi, d’injurieux ou de douloureux, voire un soufflet, m’eût rendu heureux. Je parle sérieusement : cela m’eût causé un réel plaisir, il va sans dire un plaisir amer et désespéré, mais c’est dans le désespoir que sont les plaisirs les plus ardents, surtout quand on a conscience de ce désespoir… Quoi qu’il m’arrivât, c’est toujours moi qui paraissais le principal coupable, et le plus désolant, c’est que j’étais à la fois coupable et innocent, ayant agi, pour ainsi dire, d’après ma loi naturelle. J’étais coupable d’abord, parce que je suis plus intelligent que tous ceux qui m’entourent (je me suis toujours estimé plus intelligent que les autres, et parfois, croyez-moi, j’en étais même honteux ; c’est pourquoi j’ai, durant toute ma vie, regardé obliquement les gens, jamais en face). Et puis j’étais innocent parce que… Eh bien ! parce que j’étais innocent !…»
Chapitre 3
Note perso : la comparaison filée entre l’homme malade/hyperconscient et la souris ou le rat est magnifique. Je n’arrive pas à me décider si je préfère la souris ou le rat et je suis déçue que la langue russe ne les distingue pas.
« Parce que, chez ceux qui savent se venger, ou qui savent se défendre, en général - comment cela se passe-t-il? Eux, dès qu’ils sont possédés, disons par l’idée de vengeance, ils n’ont plus rien en eux que leur idée aussi longtemps qu’ils n’atteignent pas leur but. Un monsieur de ce genre vous fonce droit au but, comme un taureau furieux, cornes baissées, il n’y a guère qu’un mur qui vous l’arrêtera. (A propos: devant le mur, ce genre de messieurs, je veux dire les hommes spontanés et les hommes d’action, ils s’aplatissent le plus sincèrement du monde. Pour eux, ce mur n’est pas un obstacle comme, par exemple, pour nous, les hommes qui pensons et qui, par conséquent, n’agissons pas; pas un prétexte pour rebrousser chemin, prétexte auquel, le plus généralement, nous ne croyons pas nous-mêmes, mais auquel nous réservons le meilleur accueil. Non, ils s’aplatissent de tout cœur. le mur agit sur eux comme un calmant, une libération morale, comme quelque chose de définitif, quelque chose même, je peux dire, de mystique... Mais - plus tard avec le mur.)
Eh bien, c’est cet homme spontané que je considère, comme l’homme le plus normal, tel que l’imaginait sa tendre mère - la nature - quand elle le mit au monde. Cet homme-là, j’en suis jaloux jusqu’à m’en faire tourner la bile. Il est idiot, nous n’en discuterons pas, mais qui vous dit qu’un homme normal ne devrait pas être un idiot - qu’en savez-vous? Peut-être est-ce même très bien. Je suis d’autant plus convaincu de ce - comment dirai-je? - soupçon, que si vous prenez, par exemple, l’antithèse de l’homme normal, c’est-à-dire l’homme à la conscience accrue, qui tire son origine non plus, bien sûr, de la nature mais du fond d’une cornue (cela, c’est presque du mysticisme, messieurs, mais c’est le soupçon que j’ai), il arrive à cet homme de la cornue de s’aplatir si fort devant son antithèse qu’il se ressent lui-même, le plus sincèrement du monde, avec toute sa conscience accrue, comme une souris, et non plus comme un homme. Une souris à la conscience accrue, peut-être, mais une souris, et là, elle voit un homme, etc. Surtout, c’est de lui-même, de sa propre initiative qu’il se prend pour une souris; personne ne le lui demande; voilà un point capital. Observons à présent cette souris en action. Supposons, par exemple, qu’elle aussi, elle a été humiliée (elle est humiliée presque perpétuellement) et qu’elle aussi, elle désire se venger. Elle accumule une rage encore plus grande que l’homme de la nature et de la vérité. Le petit désir mesquin et moche de rendre à l’offenseur la monnaie de sa pièce la ronge de l’intérieur, peut-être, d’une manière plus sale encore qu’il ne le fait chez l’homme de la nature et de la vérité, car l’homme de la nature et de la vérité, avec son idiotie congénitale, estime que sa vengeance n’est qu’une oeuvre de justice; mais la souris, à cause de sa conscience accrue, la nie, cette justice. Nous en venons enfin à l’acte en tant que tel, à la vengeance proprement dite. La malheureuse souris, en plus de sa saleté originelle, a eu le temps de s’entourer du cercle que représentent les questions et les doutes, et tant d’autres saletés; à une seule question, elle à ajouté tant d’autres questions sans réponse que c’est à son corps défendant qu’elle a vu s’amasser autour d’elle une sorte de fange mortifère, un genre de boue malodorante que viennent composer ses doutes, ses inquiétudes et, pour finir, les crachats que lui envoient les hommes d’action spontanés qui, l’entourant gravement comme ses tyrans ou ses juges, la couvrent, riant à gorge déployée, de ridicule. Bien sûr, il ne lui reste plus qu’à faire un petit geste d’impuissance avec sa patte, à s’affubler d’un sourire méprisant auquel elle ne croit pas elle-même et à filer la queue basse jusqu’à son trou. Là, au fond de son sous-sol puant, abject, notre souris humiliée, enfoncée, couverte de ridicule, se plonge immédiatement dans une rage froide et vénéneuse, une rage - voilà le point! - perpétuelle. Quarante ans de suite, elle ruminera jusqu’aux derniers, aux plus honteux détails de son humiliation et, chaque fois, elle en rajoutera de plus honteux, s’entretenant dans sa rage méchante et se moquant d’elle-même avec sa propre fantaisie. Elle aura honte elle-même de cette fantaisie, et, néanmoins, elle se rappellera tout, elle retournera tout dans tous les sens, elle s’inventera les contes les plus invraisemblables sous le prétexte que cela aussi aurait pu se passer, et elle ne se pardonnera rien. Elle commencera peut-être à se venger, mais ce sera par à-coups, par des vétilles, comme dans le dos, incognito, sans croire ni à son droit de se venger ni au succès de sa vengeance et sachant par avance que toutes ces tentatives la feront souffrir elle-même cent fois plus que celui qu’elle vise - que celui-là, peut-être, elles lui feront l’effet d’une piqûre de moustique. Et sur son lit de mort, elle se rappellera tout encore une fois, avec les intérêts accumulés, et là... Mais c’est dans ce répugnant, c’est dans ce glacial espoir-et-désespoir, dans cette inhumation volontaire et consciente sous le poids du malheur pendant quarante années dans un sous-sol, c’est dans la conscience accrue et néanmoins - fût-ce en partie - douteuse de l’impasse dans laquelle on se trouve, dans le poison de ces désirs insatisfaits qui a fini par pénétrer vos chairs, dans cette fièvre, enfin, des valses-hésitations, dans des décisions prises pour toujours et des remords qui vous reviennent une minute plus tard, que réside l’essence de la jouissance bizarre dont j’ai parlé. Elle est à ce point volatile, elle échappe parfois tellement à la conscience qu’il suffit que les gens soient un peu limités, ou qu’ils aient simplement les nerfs solides pour ne pas comprendre du tout. « J’en connais d’autres, peut-être, qui ne la comprendront pas, ajouterez-vous dans un sarcasme, ceux qui n’ont jamais reçu de gifles », ce qui serait une manière polie d’insinuer que cette expérience-là m’est arrivée peut-être à moi aussi et que j’en parle donc en connaissance de cause. Ma main au feu que vous croyez ça. Mais calmez-vous, messieurs, je n’ai jamais reçu de gifles, même si ça m’est égal ce que vous pensez à ce sujet. C’est moi, peut-être, qui regrette de ne pas en avoir assez distribué. Mais il suffit, plus un mot sur ce thème qui vous intéresse à ce point. »
Autre traduction :
« Comment font les gens qui savent se venger et en général se défendre ? Quand l’esprit de vengeance les domine, ils ne sont plus accessibles à aucun autre sentiment. L’homme offensé va droit à son but comme va un taureau furieux, les cornes baissées, et qui ne s’arrête qu’au pied d’un mur. Voilà sa force.
(À propos, au pied du mur, les gens de premier mouvement s’arrêtent. Pour eux le mur n’est pas un obstacle qu’on peut tourner, comme pour nous autres, gens qui pensons et par conséquent n’agissons pas. Non, ils s’arrêtent et se retirent franchement, le mur les calme, c’est une solution décisive et définitive, quelque chose même de mystique… Mais nous reviendrons au mur.)
Donc l’homme de premier mouvement est, à mon sens, l’homme vrai, normal, tel que le souhaitait sa tendre mère, la Nature. Je suis jaloux de cet homme au dernier point. Il est bête, j’en conviens, mais qui sait ? l’homme normal, peut-être, doit être bête. Peut-être même est-ce une beauté, cette bêtise. Pour ma part j’en suis d’autant plus convaincu que si, par exemple, je prends, par antithèse, pour homme normal celui qui a la conscience intense, qui est sorti, cela va sans dire, non de la matrice naturelle, mais d’une cornue (ça, c’est presque du mysticisme, messieurs, mais je le sais), eh bien, cet homunculusse sent parfois si inférieur à son contraire qu’il se considère lui-même, en dépit de toute son intensité de conscience, comme un rat plutôt qu’un homme, – un rat doué d’une intense conscience, mais tout de même un rat, – tandis que l’autre est un homme, et par conséquent, etc.… Surtout n’oublions pas que c’est lui-même, lui-même qui se considère comme un rat, personne ne l’en prie, – et c’est là un point important.
Voyons maintenant le rat aux prises avec l’action. Supposons par exemple qu’il soit offensé (il l’est presque toujours) : il veut se venger. Il est peut-être plus capable de ressentiment que l’homme de la nature et de la vérité [25]. Ce vif désir de tirer vengeance de l’offenseur et de lui causer le tort même qu’il a causé à l’offensé, est plus vif peut-être chez notre rat que chez l’homme de la nature et de la vérité. Car l’homme de la nature et de la vérité, par sa sottise naturelle, considère la vengeance comme une chose juste, et le rat, à cause de sa conscience intense, nie cette justice. On arrive enfin à l’acte de la vengeance. Le misérable rat, depuis son premier désir, a déjà eu le temps, par ses doutes et ses réflexions, d’accroître, d’exaspérer son désir. Il embarrasse la question primitive de tant d’autres questions insolubles, que, malgré lui, il s’enfonce dans une bourbe fatale, une bourbe puante composée de doutes, d’agitations personnelles, et de tous les mépris que crachent sur lui les hommes de premier mouvement, qui s’interposent entre lui et l’offenseur comme juges absolus et se moquent de lui à gorge déployée. Il ne lui reste évidemment qu’à faire, de sa petite patte, un geste dédaigneux, et à se dérober honteusement dans son trou avec un sourire de mépris artificiel auquel il ne croit pas lui-même. Là, dans son souterrain infect et sale, notre rat offensé et raillé se cache aussitôt dans sa méchanceté froide, empoisonnée, éternelle.
Quarante années de suite il va se rappeler jusqu’aux plus honteux détails de son offense et, chaque fois il ajoutera des détails plus honteux encore, en s’irritant de sa perverse fantaisie, inventant des circonstances aggravantes sous prétexte qu’elles auraient pu avoir lieu, et ne se pardonnant rien. Il essayera même, peut-être, de se venger, mais d’une manière intermittente, par des petitesses, de derrière le poêle [26], incognito, sans croire ni à la justice de sa cause, ni à son succès, car il sait d’avance que de tous ces essais de vengeance il souffrira lui-même cent fois plus que son ennemi.
Sur son lit de mort, il se rappellera encore, avec les intérêts accumulés et… Mais c’est précisément en ce dernier désespoir, en cette foi boiteuse, en ce conscient ensevelissement de quarante ans dans le souterrain, en ce poison des désirs inassouvis, en cette turbulence fiévreuse des décisions prises pour l’éternité et en un moment révisées que consiste l’essence de ce plaisir étrange dont je parlais. Il est si subtil et parfois si difficile à soumettre aux analyses de la conscience que les gens tant soit peu bornés ou même tout simplement en possession d’un système nerveux en bon état n’y comprendront rien. Peut-être, ajoutez-vous en souriant, ceux aussi qui n’ont jamais reçu de soufflet n’y comprendront rien, voulant me faire par là poliment entendre que j’ai dû faire l’expérience du soufflet, et que, par conséquent, j’en parle en connaisseur : je gage que c’est là votre pensée. Mais tranquillisez-vous, messieurs, je n’ai pas fait cette expérience, – quoiqu’il me soit bien égal que vous ayez de moi telle ou telle autre opinion. Je regrette bien plutôt de n’avoir pas moi-même donné assez de soufflets… Mais suffit, assez sur ce thème qui vous intéresse trop. »
Cornue : n.f. En chimie, récipient formé d'une partie arrondie et d'un col étroit, long et courbé, se terminant en pointe, dont on se sert pour la distillation.
Fig. [En parlant de créations de l'esprit] Extravagant, bizarre. Idées, raisons, visions cornues. Synon. biscornu.Tout est donc cornu ici, les idées et les bouteilles (Hugo, N.-D. Paris,1832, p. 331).
Note perso : LE MUR chez Dostoyevski = 2 + 2 + 4 = LA LOGIQUE imperturbable de la vie = Loi de la Nature = Vérité. Passage le plus important pour moi.
(le hasard INCROYABLE fait que j’ai écrit à S. Lewandovski aujourd’hui même, en P.S. d’un sms de la veille : « Je t’encourage de tout mon coeur à ne pas suivre ma voie qui n’en est pas une d’ailleurs, qui est celle du mur. Je suis peinée que « Le Mur » soit un titre déjà pris par JP Sartre, que je n’ai pas lu ». (j’ai fait un raccourci : « Le Mur » est une des nouvelles qui donne son titre au recueil, de Sartre).
« Je continue, imperturbable, sur les gens aux nerfs solides qui ne comprennent pas ce raffinement des plaisirs dont nous parlons. Ces messieurs-là, dans telle ou telle circonstance, par exemple, pourront beugler comme des taureaux, à toute gorge, ce qui, posons cela, leur fait le plus grand honneur mais, qu’ils se trouvent devant une impossibilité, ils se soumettent illico.L’impossibilité, c’est donc un mur de pierre? Quel mur de pierre? Eh, comment ça? - Les lois de la nature, les conclusions des sciences naturelles, les mathématiques. On vous démontre, par exemple, que vous descendez du singe: pas la peine de faire la grimace - acceptez-le comme c’est. Et quand on vous démontre qu’au fond, une seule goutte de votre propre graisse doit vous être plus chère qu’un bon million de vos semblables et que cet argument résout finalement les prétendues vertus et les devoirs, tous ces délires et autres préjugés - acceptez-le tel quel, qu’est-ce que vous y pouvez, c’est comme deux fois deux - mathématique. Répliquez donc, pour voir.
« Mais enfin, vous criera-t-on, on ne peut pas se révolter? C’est deux fois deux font quatre ! La nature ne vous demande pas votre avis; ça lui est bien égal, ce que vous voulez et que vous soyez d’accord ou non avec ses lois. Vous êtes forcé de la prendre comme elle est - elle, par conséquent, et tous ses résultats. Le mur, donc, c’est un mur, etc. » Mon Dieu, mais moi, ça ne m’est pas égal, les lois de la nature et de l’arithmétique, si, pour telle ou telle raison, ces lois, ces deux fois deux font quatre n’ont pas l’heur de me plaire? Bien sûr, ce n’est pas le mur que je trouerai avec mon front, si, réellement, je n’ai pas assez de force pour le trouer, mais le seul fait qu’il soit un mur de pierre et que je sois trop faible n’est pas une raison pour que je me soumette.
Comme si ce mur de pierre pouvait vraiment vous apporter le repos, comme si, vraiment, il renfermait en lui ne serait-ce qu’un seul mot d’apaisement pour cette unique raison que deux fois deux font quatre. Absurdité des absurdités! Ah non, mais - tout comprendre, avoir conscience de tout, de tous les impossibles, de tous les murs de pierre; ne se soumettre à rien, aux impossibles, aux murs de pierre, si cela vous répugne de vous soumettre; arriver par les combinaisons logiques les plus inévitables aux conclusions les plus dégoûtantes sur ce sujet toujours d’actualité que le mur de pierre, c’est comme si vous, vous en étiez coupable, même si - encore une fois - vous n’êtes, à l’évidence, coupable de rien, ce qui amène, sans dire un mot et en grinçant des dents par impuissance, à se figer voluptueusement dans l’inertie et à songer qu’il apparaît ainsi que vous n’avez même plus personne sur qui déverser votre bile; que l’objet du délit n’y est plus, vous ne le retrouverez plus jamais peut-être, vous êtes là, devant un tour d’escamotage, un truc, une pure et simple filouterie, un genre de mélasse, on ne sait quoi, on ne sait qui, et que pour vous, malgré les mystères et les trucs, ça vous fait toujours mal - et moins vous comprenez, et plus ça vous fait mal! »
Autre traduction :
« Je reviens donc paisiblement aux gens doués d’un bon système nerveux et qui ne comprennent pas les plaisirs d’une certaine acuité. Ces gens-là, si on les offense, beuglent comme des taureaux, à leur grand honneur, mais s’apaisent immédiatement devant l’impossibilité, – vous savez, le mur. Quel mur ? mais cela va sans dire, les lois de la nature, les conclusions des sciences naturelles, la mathématique. Qu’on vous démontre que l’homme descend du singe, il faut vous rendre à l’évidence, « il n’y a pas à tortiller ». Qu’on vous prouve qu’une parcelle de votre propre peau est plus précieuse que des centaines de milliers de vos proches, et qu’au bout du compte toutes les vertus, tous les devoirs et autres rêveries ou préjugés doivent s’effacer devant cela ; eh bien ! qu’y faire ? Il faut encore se rendre, car deux fois deux… c’est la mathématique ! Essayez donc de trouver une objection.
« Mais permettez, dira-t-on, il n’y a en effet rien à dire : deux fois deux font quatre. La nature ne demande pas votre autorisation. Elle n’a pas à tenir compte de vos préférences, il faut la prendre comme elle est. Un mur ? C’est un mur ! Et ainsi de suite… et ainsi de suite… »
Mon Dieu ! que m’importe la nature ? que m’importe l’arithmétique ? etc., s’il ne me plaît pas que deux et deux fassent quatre ?… »
Chapitre 4
« Ses geignements deviennent pour ainsi dire mauvais, aussi rageurs que sales, ils durent des jours et des nuits d’affilée. L’homme comprend lui-même qu’il ne s’aidera en rien à geindre comme il geint; il sait mieux que personne qu’il ne fait que s’épuiser, que s’énerver, lui-même, et tout son entourage; il sait que même le public devant lequel il s’évertue avec tant d’insistance, que toute sa famille l’écoute déjà avec dégoût, ne le croit pas le moins du monde et comprend bien qu’il pourrait geindre différemment, d’une manière simple, sans ces roulades et ces grimaces, qu’il ne s’amuse à ça que par méchanceté, que par sournoiserie. C’est dans toutes ces prises de conscience, toutes ces hontes que réside le plaisir. « Bigre, je vous dérange, je vous tire des larmes, j’empêche toute la maison de dormir. Eh bien, ne dormez pas, sentez chaque seconde que j’ai une rage de dents. Maintenant, j’ai cessé d’être ce héros que je voulais être devant vous, je ne suis plus qu’un homme ridicule, un mauvais drôle. Tant mieux! Je suis heureux que vous m’ayez percé à jour. Ça vous dégoûte d’entendre mes sales petits gémissements? Moi, ça me plaît de vous rendre malades; tenez, je vais vous faire un de ces trilles qui vous dégoûtera encore plus... » Vous ne comprenez toujours pas, messieurs? Non, je vois qu’il faut se développer longtemps, il faut longtemps cultiver sa conscience pour saisir les méandres de cette jouissance-là! Vous riez? Parfait. Bien sûr, messieurs, je fais des plaisanteries de mauvais goût, elles sont inégales, hésitantes, elles doutent sitôt qu’elles sont lancées. C’est que je ne m’estime pas moi-même. Un homme doué d’une conscience est-il capable de s’estimer un tant soit peu? »
Autre traduction :
« – Mais ne comprenez-vous pas que je n’ai aucun souci de ce que je peux dire, n’ayant aucune estime de moi-même ? Est-ce qu’un homme conscient peut s’estimer ? »
Note perso : semi-identification. Je m’en veux régulièrement de chouiner publiquement car je sais que cela m’enfonce prodigieusement et incite au mépris de la majorité envers ma personne mais je le fais quand même. Par plaisir ? NON. Par méchanceté ? NON. Pour ne pas souffrir en silence d’une part et pour ne pas permettre aux gens bien-pensants qui ne souffrent jamais de rien d’avoir la conscience tranquille, d’autre part. Il s’agit moins de vouloir nuire à autrui que de vouloir déranger les consciences tranquilles et endormies de la société voire « positives » (les plus agaçantes à mon sens). C’est une nuance subtile, j’en conviens, mais tellement importante pour moi.
Chapitre 5
Note perso : Hommes d’action (bêtes et limités) versus Homme passif (intelligent et réfléchi) + Le rôle prépondérant de l’ENNUI dans le MENSONGE à soi-même. C’est la partie « Don Quichotte » du texte.
Le narrateur explique que les gens normaux attribuent du sens à leurs actes tandis que lui, qui réfléchit, sait très bien qu’il n’y en a pas donc ne peut pas agir comme les gens normaux et reste dans l’inertie. La figure du taureau « qui trouve toujours une solution » en voulant à tout prix rendre concret un problème abstrait me fait énormément penser à Sabine. Elle est exactement comme ça (et bélier de signe astrologique).
« Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l’on s’estime encore un tant soit peu si l’on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ? Ce n’est pas je ne sais quel remords à la Tartuffe qui me fait dire ce que je dis. En général, jamais je n’ai pu supporter de dire : « Pardon, papa, je ne le ferai plus » - non que je fusse incapable de le dire, au contraire, peut-être, c’est justement que j’en étais trop capable, et dans quelles circonstances ! Des fois, je me faisais prendre, comme par hasard, dans des histoires où j’étais innocent comme l’enfant qui vient de naître. C’était là le plus moche. Et, avec ça, je m’émotionnais de fond en comble, je me repentais, je versais des flots de larmes et il va de soi que je me bernais tout seul, et je ne faisais pas semblant le moins du monde. Le cœur, ou quoi, qui s’amochait… Là, on ne pouvait même pas accuser les lois de la nature qui m’humiliaient le plus et le plus constamment toute la vie. C’est moche de repenser à ça, et c’était moche sur le coup. Parce qu’une minute plus tard, des fois, je comprenais rageusement que tout cela n’était que du mensonge, oui, du mensonge, un monstrueux mensonge de façade, je veux dire ces remords, ces émotions, tous ces serments de renaissance. Demandez-moi pourquoi je me démolissais et je me torturais tout seul de cette façon. Réponse : parce que je m’ennuyais de rester les bras croisés ; d’où ces chinoiseries. Absolument. Observez-vous un petit peu plus vous-mêmes, messieurs, vous comprendrez que c’est comme ça. Je m’inventais moi-même des aventures, une vie – pour vivre, ne fût-ce qu’un petit peu. Combien de fois m’est-il arrivé, eh bien, ne serait-ce que de me vexer, comme ça, pour rien, exprès ; des fois, je n’en savais rien, pourquoi j’étais vexé, je m’étais mis le masque, mais ça en arrivait au point où, pour le coup, je me trouvais une raison valable. Toute ma vie j’ai été attiré par ce genre d’histoires, au point que, pour finir, j’étais vraiment lancé. Une fois même, j’ai voulu me forcer à tomber amoureux – et même deux fois. Et je souffrais, messieurs, je vous en fiche mon billet. Au fond du cœur, on n’y croit pas, qu’on souffre, c’est un sarcasme qui vous remue, mais moi, je souffre, et de la manière la plus vraie, la plus réglementaire ; je suis jaloux, je bous et je trépigne… Et tout cela, messieurs, c’est par ennui – oui, par ennui ; le poids de l’inertie. Car elle est un fruit direct, légitime, une conséquence logique de la conscience, cette inertie – cette position consciente les bras croisés. J’en ai parlé plus haut. Je le répète, je répète et j’insiste : les hommes spontanés, les hommes d’action sont justement des hommes d’action parce qu’ils sont bêtes et limités. Comment j’explique cela ? Très simple : c’est cette limitation qui leur fait prendre les causes les plus immédiates, donc les causes secondaires, pour des causes premières ; ainsi parviennent-ils plus facilement et plus vite que les autres à se convaincre d’avoir trouvé la base indubitable de leur affaire – et ça les tranquillise ; et c’est là l’essentiel. Parce que, pour se mettre à agir, il faut d’abord avoir l’esprit tranquille, il faut qu’il n’y ait plus la moindre place pour les doutes. Mais, par exemple, moi, comment ferais-je pour avoir l’esprit tranquille ? Pour moi, où sont-elles donc, les causes premières qui me serviront d’appui, où sont les bases ? D’où est-ce que je les prendrais ? Je m’exerce à penser ; par conséquent, chez moi, toute cause première en fait immédiatement surgir une autre, plus première encore, et ainsi de suite jusqu’à l’infini. Telle est l’essence de toute conscience et de toute pensée. Encore, si vous voulez, une loi de la nature. Et quel est donc le résultat final ? Toujours la même chose. Souvenez-vous de ce que j’ai dit de la vengeance. (Vous n’avez rien compris, je parie). On dit : l’homme se venge parce qu’il trouve là une chose juste. C’est donc qu’il a trouvé sa cause première, sa base – en l’occurrence : la justice. Il peut donc être tranquille sur tous les plans, d’où – il se venge tranquillement et avec succès, convaincu qu’il est d’accomplir un acte aussi noble que juste. Mais moi, je n’en vois pas, de justice, là-dedans, et je n’y vois non plus aucune vertu, et donc, si je commence à me venger, je ne le ferai que par méchanceté. Cette méchanceté pourrait évidemment l ‘emporter sur mes doutes, et pourrait donc, ainsi, servir de cause première justement parce qu’elle n’est pas une cause. Mais qu’est-ce que je peux faire si je n’ai même pas de méchanceté (c’est bien par ça que j’ai commencé) ? La méchanceté, à cause de ces maudites lois de la conscience, elle est soumise à une désagrégation chimique. Un geste – et l’objet devient gaz, les raisons s’évaporent, le coupable disparaît, l’offense cesse d’être une offense, elle devient un fatum, quelque chose comme une rage de dents dont personne n’est coupable, et, de nouveau, il ne vous reste donc qu’une seule issue – cogner le mur, pour que ça lui fasse très mal. Et bon, on laisse tomber, parce qu’on n’a pas trouvé la cause première. Essayez un peu de vous laisser emporter à l’aveuglette par votre passion, sans réfléchir, sans cause première, essayez de chasser la conscience ne serait-ce qu’à ces moments ; aimer, haïr – mais ne plus rester les bras croisés. Le lendemain, ou le jour d’après, grand maximum, vous commencerez à vous mépriser de vous être berné vous-même comme ça, en toute connaissance de cause. Le résultat ? Bulle de savon et inertie. Ah, messieurs, mais il est bien possible que la seule raison pour laquelle je me prenne pour un homme intelligent, c’est que, de toute ma vie, je n’ai jamais rien pu commencer ni achever. ÇA va, ça va, je ne suis qu’un bavard, rien qu’un bavard inoffensif et contrariant, comme tout le monde. Mais qu’est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c’est-à-dire d’agiter les bras pour faire du vent ? »
Autre traduction :
« …Observez-vous mieux vous-mêmes, et vous me comprendrez, messieurs. Que de fois j’ai imaginé des aventures et composé ma vie comme un livre ! Que de fois il m’est arrivé, par exemple, de m’offenser d’un rien, exprès, sans motif ! Mais on se monte si facilement et si bien qu’à la fin on se croit véritablement offensé. J’ai bien souvent joué ce jeu, de telle sorte que j’ai fini par m’y prendre et que je n’étais plus maître de moi-même. D’autres fois, j’ai voulu me rendre amoureux de force. J’ai bien souffert, je vous jure…
Je n’ai connu de pires souffrances que celles – pourtant mêlées de douceurs – que j’endurai quand Katia me laissa voir qu’elle pourrait m’aimer et presque aussitôt m’abandonna. Pourtant, si j’avais su vouloir, je l’aurais retenue ! J’aurais écarté le vieillard, l’horrible mechtchanine !… Mais à quoi bon réveiller des souvenirs qui me tuent ! D’ailleurs, c’est une histoire que vous ignorez…
Ô messieurs, ne serait-ce pas précisément parce que je n’ai jamais rien pu finir ni commencer que je me considère comme un homme intelligent ? Soit, je suis un bavard inoffensif, – comme tout le monde ! – Mais quoi ? ce bavardage, n’est-ce pas la destinée unique de tout « homme intelligent, – ce bavardage, c’est-à-dire l’action de verser le rien dans le vide ? »
Chapitre 6
Note perso : de l'agacement de Dostoievski contre le « beau et le sublime » passé un certain âge (40 ans). Il réserve ces sensations puériles -pures- à la jeunesse et comme je le comprends moi qui serais prête à vendre mon âme au diable pour retrouver ces sensations, ces perceptions !
Ce « beau » et ce « sublime », je l’avoue, ils me tapent sérieusement sur le système, la quarantaine venue; mais c’est que j’ai quarante ans - à l’époque, la chose aurait été toute autre! Non, à l’époque, je me serais trouvé une activité - je veux dire boire à la santé de tout ce qu’est le beau et le sublime. Je me serais accroché à toutes les occasions pour commencer par verser une larme dans ma coupe, puis pour la boire à la santé du beau et du sublime. C’est le monde entier, à ce moment-là, que j’aurais vu en beau et en sublime. Dans la saleté la plus minable, la plus patente, j’aurais trouvé du beau et du sublime. Je serais devenu larmoyant comme une éponge mouillée. Un peintre, par exemple, vous aurait peint un tableau de Gay. Je bois tout de suite à la santé du peintre qui a peint ce tableau de Gay, parce que j’aime le beau et le sublime. Un auteur a écrit Comme il plaît à chacun; je bois tout de suite à la santé de chacun à qui ça plaît, parce que j’aime le beau et le sublime. Et je demande qu’on me montre du respect pour cet amour, je persécute ceux qui ne m’en montrent pas. Je vis tranquille, je meurs en triomphant - ah, mais c’est formidable, formidable! Et je me serais laissé pousser une de ces bedaines, je me serais arrangé un de ces triples mentons, je me serais sculpté un de ces nez de poivrot tel que n’importe qui en me voyant se serait dit: « Ben mon vieux, ça c’est du positif! » Dites ce que vous voulez, messieurs, il est bien agréable d’entendre ces exclamations en notre époque négative.
Chapitre 7
Note perso : à propos de l’action (le mal) versus « l’intérêt » (le bien) et le réel intérêt individuel dont il fait grand cas avec beaucoup de suspense : la volonté de lutter contre la logique générale, la raison générale, la LIBERTE d’être SOI, la liberté d’être singulier, qu’il nomme également « caprice » et « fantaisie », l’INDÉPENDANCE. (Cf. Solipscisme).
Le narrateur explique que l’humanité n’a jamais évolué vers plus d’humanité avec le temps, que l’évolution de la civilisation n’a rien changé à sa soif d’horreurs sanglantes. Autrement dit, l’homme n’agit pas dans son intérêt depuis la nuit des temps, quand bien même l’Histoire lui a parfaitement appris à distinguer le bien du mal, l’humain de l’inhumain.
C’est le même message que « Rhinocéros » de Ionesco, atemporel.
Mais ce sont là que des rêves dorés. Oh, dîtes moi qui a dit le premier, qui a énoncé le premier que si les hommes faisaient des saletés, c’est seulement qu’ils ne connaissaient pas leurs véritables intérêts? qu’il suffisait de les éclairer, de leur ouvrir les yeux sur ces intérêts véritables pour qu’ils arrêtent à l’instant de faire leurs saletés - que, s’ils sont éclairés sur leur véritable profit, s’ils le comprennent, ils deviendront honnêtes et bons en un clin d’œil et que c’est dans le bien qu’ils verront ce profit, car on sait bien que personne ne peut agir sciemment contre son intérêt, qu’ils feront donc le bien, pour ainsi dire, par nécessité. O pauvre enfant ! O pur et innocent bébé! Mais, tout d’abord, quand donc avez-vous vu, dans tous les millénaires, que les hommes n’agissaient que dans leur intérêt? Que faites-vous de ces millions d’actions qui témoignent que les hommes, en toute conscience, c’est-à-dire dans la pleine compréhension de leur intérêt véritable, le laissent au deuxième plan pour se lancer sur un autre chemin, celui du risque, du hasard, sans y être forcés par rien ni par personne, comme si, justement, ils voulaient tout sauf une route balisée, et qu’ils s’en ouvrent une autre, avec obstination, sans aucune raison - une autre, absurde, plus pénible, dont c’est tout juste s’ils ne se l’ouvrent pas dans les ténèbres? Parce que, n’est-ce pas, c’est leur obstination et leur lubie qu’ils préfèrent à leur intérêt... Un intérêt... Qu’est-ce que c’est donc, un intérêt? Et puis, pouvez-vous prendre sur vous de définir à coup sûr ce qui est intéressant pour l’homme? Et que se passerait-il si cet intérêt, certaines fois, certaines fois, non seulement pouvait, mais devait consister, justement, à se souhaiter non pas ce qui est profitable, mais ce qui est le pire? Et s’il en est ainsi, si ce genre de situations peut se produire, alors, c’est toute votre loi qui tombe à l’eau. Qu’en dites-vous, ces situations existent? Vous riez; riez, messieurs, mais répondez; ce qui profite à l’homme peut-il toujours être établi sans un risque d’erreur? N’y a-t-il pas des cas qui, non seulement n’entrent pas, mais ne peuvent pas entrer dans une classification? Parce que, messieurs, autant que je le sache, votre grand registre de nos intérêts, vous l’avez pris dans la moyenne des chiffres statistiques et des formules des sciences de l’économie. Vos intérêts, qu’est-ce que c’est? Le bien-être, la richesse, la liberté, le calme, etc.; de sorte que les hommes, qui, par exemple, iraient délibérément à l’encontre de cette liste ne seraient, d’après vous, rien d’autre que des obscurantistes, ou carrément des fous, n’est-ce pas? Mais, une chose étonnante; comment se fait-il que toutes ces statistiques, ces sages, ces amis du genre humain, énumérant les intérêts des hommes en oublient toujours un? Ils ne le prennent même pas en compte au sens où il le faudrait, et c’est pourtant de cela que leur calcul dépend. Le malheur ne serait pas bien grand, si on le prenait, cet intérêt, pour l’inclure sur la liste. Mais là est toute la catastrophe, que cet intérêt si fameux n’apparaît dans aucune classification, ne trouve sa place dans aucune liste. Par exemple, j’ai un ami... D’ailleurs, messieurs, c’est votre ami à vous aussi; et de qui donc, oui, de qui donc n’est-il pas l’ami ? En se mettant à faire quelque chose, ce monsieur-là vous expliquera tout de suite, d’une manière claire et pontifiante, comment il faut agir précisément selon les lois de la raison et de la vérité. Bien plus: c’est avec feu et émotion qu’il vous peindra les véritables intérêts de l’espèce humaine, ses intérêts normaux; il accusera d’un ton moqueur ces taupes imbéciles qui ne comprennent ni leurs intérêts ni la vraie signification de la vertu; et - un quart d’heure, à peine, plus tard, sans aucune raison impondérable ou extérieure, non - par on ne sait quelle raison tout à fait intérieure, bien plus puissante que tous ses intérêts, il vous sortira une chose exactement inverse, il se placera en contradiction flagrante avec ce qu’il vient de dire: contre les lois de la raison, contre ses propres intérêts, bref, contre tout... Je vous préviens que cet ami est un personnage collectif, c’est pourquoi il me semble délicat de l’accuser tout seul. Mais c’est ce que je dis, messieurs: n’existe-t-il pas réellement quelque chose qui est plus cher à presque tous les hommes que leurs intérêts les plus grands, ou bien (pour ne pas aller contre la logique), est-ce qu’il n’existe pas un intérêt qui est le plus intéressant (celui-là même que tout le monde omet, et dont je viens de parler), un intérêt primordial, plus intéressant que tous les autres intérêts et au nom duquel, si cela s’avère nécessaire, les hommes sont prêts à braver toutes les lois - parfaitement, à se dresser contre le bon sens, l’honneur, le calme, le bien-être - bref, à se dresser contre tout ce qui est utile et beau, dans le seul but d’atteindre cet intérêt premier, cet intérêt le plus intéressant et qui leur est plus cher que tout?
- Bah, ça reste un intérêt, répliquez-vous, m’interrompant. Attendez donc, messieurs, nous aurons le temps de nous expliquer, il ne s’agit pas de faire des calembours, mais de ceci: cet intérêt-là est d’autant plus remarquable qu’il détruit toutes nos classifications et qu’il démolit constamment tous les systèmes imaginés par les amis du genre humain pour le bonheur du genre humain; que, bref, il dérange tout le monde... Mais avant de vous le nommer, cet intérêt, je veux me compromettre personnellement et c’est pourquoi j’affirme, comme par défi, que tous ces beaux systèmes, ces théories pour expliquer à notre humanité ses intérêts réels et naturels afin que son nécessaire élan pour les atteindre, ces intérêts, l’emplisse immédiatement de bonté et de noblesse, que, tous donc, ils ne sont pour le moment, à mon avis, que de la fausse logique! Car enfin, ne serait-ce qu’affirmer cette théorie d’une régénération du genre humain dans son ensemble par un système fondé sur ses propres intérêts, c’est, d’après moi, ou peu s’en faut, la même chose... eh bien, qu’affirmer, par exemple, à la suite de Buckle, que l’homme s’adoucit avec la civilisation et que, par conséquent, il devient moins sanguinaire et moins capable de faire la guerre. La logique veut que ça paraisse vrai. Mais l’homme est à ce point esclave de son système et de ses conclusions abstraites qu’il est prêt, en toute conscience, à déformer la vérité, prêt à ne plus rien voir, à ne plus rien entendre, du moment qu’il justifie mieux cette logique. Voilà pourquoi je prends ça en exemple, c’est un exemple trop frappant. Regardez autour de vous: le sang coule à grands flots, et d’une façon tellement joyeuse, encore, on dirait du champagne. Et c’est cela, notre XIXe siècle dont Buckle fut le contemporain. Regardez Napoléon le Grand, et celui d’aujourd’hui. Regardez l’Amérique du Nord - cette union perpétuelle. Regardez, enfin, cette caricature qu’est le Schleswig-Holstein... Qu’est-ce donc qu’elle adoucit en nous, la civilisation? Tout ce fait la civilisation, c’est qu’elle amène à une plus grande complexité de sensations... absolument rien d’autre. Je parie même que, cette complexité se développant, elle peut aller jusqu’au point où elle nous fera découvrir des plaisirs jusque dans le sang. Cela s’est déjà produit. Avez-vous remarqué que les buveurs de sang les plus raffinés furent presque tous les hommes les plus civilisés qui soient, même si les Attila et les Stenka Razine ne leur arrivaient pas à la cheville, parfois, et que, s’ils sont peut-être moins visibles qu’Attila et les Stenka Razine, c’est simplement qu’ils sont devenus communs, trop ordinaires, qu’ils sont rentrés dans le rang? La civilisation, si elle n’a pas rendu les hommes plus sanguinaires, a conféré à cette cruauté quelque chose de plus sale, de plus odieux. Avant, les hommes voyaient dans le meurtre un acte de justice, ils étripaient donc qui ils devaient sans remords de conscience; maintenant, nous avons beau savoir que le meurtre est une saloperie, nous la pratiquons de plus belle, cette saloperie, et encore plus qu’avant. Qu’est-ce qui est pire? - À vous de décider.
Stepan (Stenka) Timofeïevitch Razine (en russe : Степан (Стенька) Тимофеевич Разин, en ukrainien : Степан Тимофійович Разін) (1630-1671) est un chef cosaque, qui mena un soulèvement contre la noblesse et la bureaucratie tsariste dans le sud de la Russie. (Wikipédia)
Cosaque du Don qui dirigea le soulèvement des paysans et des populations de la Volga, notamment les Mordves, contre le gouvernement tsariste. Né dans le village de Zimoveïski sur le Don, d'une famille aisée, Stenka Razine, homme pieux (il fit deux pèlerinages, en 1652 et 1661, au monastère Solovetski et à Moscou en mémoire de son père), se destinait à une carrière diplomatique et militaire chez les Cosaques du Don : de 1660 à 1662, il fait partie des ambassades russes et cosaques qui cherchent à gagner l'alliance des princes kalmouks contre les Tatars de Crimée ; en 1663, grâce à cette alliance, il parvient à battre ces mêmes Tatars près de Perekop.
Toutefois, dès cette époque, il se rend compte de l'attitude méprisante de l'administration moscovite à l'égard des Cosaques ; en 1665, le prince Iouri Dolgorouki, commandant en chef de l'armée contre les Polonais, fait exécuter son frère Ivan. Dès lors, Razine éprouvera une haine farouche à l'encontre du pouvoir tsariste et demeurera animé d'un profond désir de vengeance. (Universalis).
"Stenka Razine, le Robin des Bois russe"
Je recommande cette source pour en savoir plus : http://www.revuemethode.org/m101817.html
Il paraît que Cléopâtre (passez-moi cet exemple d’histoire romaine) aimait enfoncer des épingles dorées dans les seins de ses servantes et qu’elle trouvait une jouissance dans leurs tortillements et dans leurs cris. Vous me direz que cela se passait à une époque qu’on pourrait dire relativement barbare; que maintenant aussi, c’est une époque barbare parce que, maintenant aussi (toujours relativement parlant) on enfonce des épingles; que maintenant aussi, même si les hommes ont su apprendre quelquefois à se faire une vision plus claire qu’aux époques barbares, ils sont loin d’avoir appris à agir selon ce que leur dictent les sciences ou la raison. Et, néanmoins, vous êtes toujours persuadés qu’ils finiront bien par apprendre, quand on ne sait quelles ancestrales et détestables habitudes seront définitivement passées, que le bon sens et les sciences réunis les rééduqueront de fond en comble et dirigeront leur humaine nature vers sa voie naturelle. Vous êtes persuadés qu’alors, c’est d’eux-mêmes qu’ils cesseront de se tromper volontairement et que, pour ainsi dire, c’est malgré eux qu’ils ne chercheront plus à séparer leur liberté de leurs intérêts normaux. Bien plus: alors, dites-vous, c’est la science en tant que telle qui apprendra aux hommes (encore que là, ce soit même du luxe, à mon avis) qu’en fait, ils n’ont ni volontés ni caprices, qu’au fond, ils n’en n’ont jamais eu, et qu’ils ne sont eux-mêmes rien d’autre que des espèces de touches de piano, ou des goupilles d’orgue; et que, en plus de tout cela, il y a encore les lois de la nature; de sorte que tous les actes qu’ils font ne se font pas selon leur volonté, mais par eux-mêmes, d’après les lois de la nature. Il suffit donc de découvrir ces lois de la nature et l’homme pourra cesser de répondre de ses actes, ce qui simplifiera sa vie d’une façon considérable. Toutes les actions humaines seront d’elles-mêmes classées selon ces lois, mathématiquement, un peu comme des tables de logarithmes, jusqu’à 108000, elles seront inscrites à l’almanach; ou, mieux encore, on pourra voir paraître des éditions utiles du genre de nos dictionnaires encyclopédiques, où tout sera noté et codifié avec une telle exactitude qu’il n’y aura plus jamais d’actes ni d’aventures. - Alors - c’est toujours vous qui parlez - s’instaureront de nouvelles relations économiques, toutes prêtes à l’usage, calculées, elles aussi, avec une exactitude mathématique, de sorte qu’en un instant disparaîtront tous les problèmes possibles et imaginables, pour cette unique raison, en fait, qu’ils trouveront toutes les réponses possibles et imaginables. Alors, on verra se construire un palais de cristal. Alors... Bon, bref, c’est l’Oiseau bleu qui nous rendra visite. Evidemment, nul ne peut garantir d’aucune façon (c’est moi qui parle maintenant) qu’alors, disons, la vie ne sera pas mortellement ennuyeuse (parce que, à quoi sert de faire quoi que ce soit, si c’est déjà inscrit sur une tablette?), mais elle sera parfaitement raisonnable. Certes, que n’inventerait-on pas quand on s’ennuie! Car les épingles d’or, c’est aussi par ennui qu’on les enfonce - mais laissons ça. Ce qui est moche (c’est encore moi qui parle), c’est qu’on pourrait bien voir les hommes se réjouir de ces épingles d’or. Parce que l’homme est bête, phénoménalement bête. C’est-à-dire, il est loin d’être bête, mais il est tellement ingrat que rien au monde ne l’est plus que lui. Moi, par exemple, ça ne m’étonnerait pas du tout, de voir surgir, comme ça, sans prévenir, en plein milieu de cette raison régnante, un monsieur au physique ingrat, ou, pour mieux dire, rétrograde et sarcastique, qui se mettrait les deux mains sur les hanches et qui dirait: Dites-donc, messieurs, est-ce qu’on ne pourrait pas l’envoyer valdinguer, toute cette raison, d’un seul coup de pied, seulement pour envoyer ces logarithmes au diable, et pour vivre à nouveau selon notre liberté stupide? Ça, encore, ce n’est rien, mais le malheur, c’est qu’il trouvera obligatoirement des partisans: l’homme est ainsi fait. Et tout cela, pour cette raison tellement idiote qu’il serait malséant, sans doute de la mentionner: c’est que les hommes, partout et de tout temps, qui qu’ils puissent être, aiment agir comme ils le veulent, et non comme le leur dictent la raison et leur propre intérêt; vouloir contre son intérêt est non seulement possible, c’est quelquefois positivement obligatoire (cela, c’est déjà mon idée). Leur volonté particulière, libre, affranchie de contraintes, leur caprice individuel, fût-il le plus farouche, leur fantaisie, exacerbée parfois jusqu’à la folie même - c’est bien cela, cet intérêt omis, ce plus profitable de tous les profits, qui n’entre dans aucune classification et qui envoie perpétuellement au diable tous les systèmes et toutes les théories. Car quoi, où les savants ont-ils pu bien trouver que les hommes ont besoin de je ne sais quelle volonté naturelle, de je ne sais quelle volonté de vertu? Ce dont les hommes ont besoin - c’est seulement d’une volonté indépendante, quel que soit le prix de cette indépendance, et quelles que soient ses conséquences. Bon, et la volonté, le diable sait de quoi... »
 |
| STENKA RAZINE : à plusieurs fois évoqué par Dostoïevski. |
Cosaque du Don qui dirigea le soulèvement des paysans et des populations de la Volga, notamment les Mordves, contre le gouvernement tsariste. Né dans le village de Zimoveïski sur le Don, d'une famille aisée, Stenka Razine, homme pieux (il fit deux pèlerinages, en 1652 et 1661, au monastère Solovetski et à Moscou en mémoire de son père), se destinait à une carrière diplomatique et militaire chez les Cosaques du Don : de 1660 à 1662, il fait partie des ambassades russes et cosaques qui cherchent à gagner l'alliance des princes kalmouks contre les Tatars de Crimée ; en 1663, grâce à cette alliance, il parvient à battre ces mêmes Tatars près de Perekop.
Toutefois, dès cette époque, il se rend compte de l'attitude méprisante de l'administration moscovite à l'égard des Cosaques ; en 1665, le prince Iouri Dolgorouki, commandant en chef de l'armée contre les Polonais, fait exécuter son frère Ivan. Dès lors, Razine éprouvera une haine farouche à l'encontre du pouvoir tsariste et demeurera animé d'un profond désir de vengeance. (Universalis).
"Stenka Razine, le Robin des Bois russe"
Je recommande cette source pour en savoir plus : http://www.revuemethode.org/m101817.html
Il paraît que Cléopâtre (passez-moi cet exemple d’histoire romaine) aimait enfoncer des épingles dorées dans les seins de ses servantes et qu’elle trouvait une jouissance dans leurs tortillements et dans leurs cris. Vous me direz que cela se passait à une époque qu’on pourrait dire relativement barbare; que maintenant aussi, c’est une époque barbare parce que, maintenant aussi (toujours relativement parlant) on enfonce des épingles; que maintenant aussi, même si les hommes ont su apprendre quelquefois à se faire une vision plus claire qu’aux époques barbares, ils sont loin d’avoir appris à agir selon ce que leur dictent les sciences ou la raison. Et, néanmoins, vous êtes toujours persuadés qu’ils finiront bien par apprendre, quand on ne sait quelles ancestrales et détestables habitudes seront définitivement passées, que le bon sens et les sciences réunis les rééduqueront de fond en comble et dirigeront leur humaine nature vers sa voie naturelle. Vous êtes persuadés qu’alors, c’est d’eux-mêmes qu’ils cesseront de se tromper volontairement et que, pour ainsi dire, c’est malgré eux qu’ils ne chercheront plus à séparer leur liberté de leurs intérêts normaux. Bien plus: alors, dites-vous, c’est la science en tant que telle qui apprendra aux hommes (encore que là, ce soit même du luxe, à mon avis) qu’en fait, ils n’ont ni volontés ni caprices, qu’au fond, ils n’en n’ont jamais eu, et qu’ils ne sont eux-mêmes rien d’autre que des espèces de touches de piano, ou des goupilles d’orgue; et que, en plus de tout cela, il y a encore les lois de la nature; de sorte que tous les actes qu’ils font ne se font pas selon leur volonté, mais par eux-mêmes, d’après les lois de la nature. Il suffit donc de découvrir ces lois de la nature et l’homme pourra cesser de répondre de ses actes, ce qui simplifiera sa vie d’une façon considérable. Toutes les actions humaines seront d’elles-mêmes classées selon ces lois, mathématiquement, un peu comme des tables de logarithmes, jusqu’à 108000, elles seront inscrites à l’almanach; ou, mieux encore, on pourra voir paraître des éditions utiles du genre de nos dictionnaires encyclopédiques, où tout sera noté et codifié avec une telle exactitude qu’il n’y aura plus jamais d’actes ni d’aventures. - Alors - c’est toujours vous qui parlez - s’instaureront de nouvelles relations économiques, toutes prêtes à l’usage, calculées, elles aussi, avec une exactitude mathématique, de sorte qu’en un instant disparaîtront tous les problèmes possibles et imaginables, pour cette unique raison, en fait, qu’ils trouveront toutes les réponses possibles et imaginables. Alors, on verra se construire un palais de cristal. Alors... Bon, bref, c’est l’Oiseau bleu qui nous rendra visite. Evidemment, nul ne peut garantir d’aucune façon (c’est moi qui parle maintenant) qu’alors, disons, la vie ne sera pas mortellement ennuyeuse (parce que, à quoi sert de faire quoi que ce soit, si c’est déjà inscrit sur une tablette?), mais elle sera parfaitement raisonnable. Certes, que n’inventerait-on pas quand on s’ennuie! Car les épingles d’or, c’est aussi par ennui qu’on les enfonce - mais laissons ça. Ce qui est moche (c’est encore moi qui parle), c’est qu’on pourrait bien voir les hommes se réjouir de ces épingles d’or. Parce que l’homme est bête, phénoménalement bête. C’est-à-dire, il est loin d’être bête, mais il est tellement ingrat que rien au monde ne l’est plus que lui. Moi, par exemple, ça ne m’étonnerait pas du tout, de voir surgir, comme ça, sans prévenir, en plein milieu de cette raison régnante, un monsieur au physique ingrat, ou, pour mieux dire, rétrograde et sarcastique, qui se mettrait les deux mains sur les hanches et qui dirait: Dites-donc, messieurs, est-ce qu’on ne pourrait pas l’envoyer valdinguer, toute cette raison, d’un seul coup de pied, seulement pour envoyer ces logarithmes au diable, et pour vivre à nouveau selon notre liberté stupide? Ça, encore, ce n’est rien, mais le malheur, c’est qu’il trouvera obligatoirement des partisans: l’homme est ainsi fait. Et tout cela, pour cette raison tellement idiote qu’il serait malséant, sans doute de la mentionner: c’est que les hommes, partout et de tout temps, qui qu’ils puissent être, aiment agir comme ils le veulent, et non comme le leur dictent la raison et leur propre intérêt; vouloir contre son intérêt est non seulement possible, c’est quelquefois positivement obligatoire (cela, c’est déjà mon idée). Leur volonté particulière, libre, affranchie de contraintes, leur caprice individuel, fût-il le plus farouche, leur fantaisie, exacerbée parfois jusqu’à la folie même - c’est bien cela, cet intérêt omis, ce plus profitable de tous les profits, qui n’entre dans aucune classification et qui envoie perpétuellement au diable tous les systèmes et toutes les théories. Car quoi, où les savants ont-ils pu bien trouver que les hommes ont besoin de je ne sais quelle volonté naturelle, de je ne sais quelle volonté de vertu? Ce dont les hommes ont besoin - c’est seulement d’une volonté indépendante, quel que soit le prix de cette indépendance, et quelles que soient ses conséquences. Bon, et la volonté, le diable sait de quoi... »
Autre traduction :
Chapitre 8
Note perso : Un des plus beaux passages si ce n’est le plus beau.
Le narrateur tente d’expliquer à ses détracteurs imaginaires que la volonté ne peut pas aller avec la raison car alors la vie serait trop triste, déjà programmée à l’avance, donc que la plus grande des libertés, paradoxalement vitale, c’est d’aller à l’encontre de ses propres intérêts raisonnablement bénéfiques.
C’est ce que j’ai toujours voulu dire à travers l’acte de fumer en prenant l’exemple des animaux de base : les animaux ne fument pas. Cela ne leur viendrait même pas à l’idée.
C’est un passage qu’a sans doute dû lire Aldous Huxley pour écrire le Meilleur des Mondes dont il faut absolument que je retrouve ma page préférée pour vous le montrer.
« Bien plus: l’homme cessera tout de suite d’être un homme et deviendra une goupille d’orgue, ou quelque chose comme ça; parce que qu’est-ce que c’est donc qu’un homme sans désirs, sans volontés, sans souhaits, sinon une goupille dans un jeu d’orgue? Qu’en pensez-vous? Examinons les probabilités - cela peut-il arriver, oui ou non?
Car si la volonté, un beau jour, se met vraiment de mèche avec la raison, c’est donc, alors, que nous raisonnerons et que nous arrêterons de vouloir parce qu’il est impossible, par exemple, en gardant sa raison, de vouloir une chose absurde, d’aller de cette façon, en toute conscience, à l’encontre de la raison et de vouloir du mal... Et comme tous les désirs et les raisonnements peuvent être calculés réellement, parce qu’on finira bien par découvrir un jour les lois de notre prétendu libre arbitre, donc, c’est bien vrai, que - je ne ris pas - il peut en découler quelque chose comme une table, de sorte que, vraiment, nous nous mettrons à faire nos volontés selon cette table. Si, par exemple, un jour, on me dénombre et on me prouve que si j’ai dit « merde » à quelqu’un, c’était évidemment parce que je ne pouvais pas ne pas le dire, et que je devais le dire avec exactement l’intonation qui fut la mienne, alors, qu’est-ce qu’il me restera de libre en moi, surtout si je suis instruit, et que j’ai un diplôme? A ce moment, je peux prévoir ma vie pour les trente ans à venir; bref, si cela se fait, nous autres, il ne nous restera plus rien à faire; de toute façon, il faudra bien se soumettre. En général, ce que nous avons à faire sans nous lasser, c’est de nous répéter qu’obligatoirement, à telle minute et dans telles circonstances, la nature ne nous demande pas notre avis; qu’il faut que nous l’acceptions telle qu’elle est et non pas telle que nous nous la représentons dans nos fantasmes, et que s’il est vraiment exact que nous voulions aller vers les tablettes et le calendrier, et... euh, oui, eh bien, même vers les cornues, alors, donc, que voulez-vous, il faudra bien admettre les cornues! Sinon, c’est la cornue qui s’admettra toute seule, sans nous...
- Eh oui, mes bons messieurs, c’est là que je vous y prends! Messieurs, pardonnez-moi de m’être lancé dans la philosophie; mais, quarante ans de sous-sol! je peux bien me permettre un peu de fantaisie. Voyez-vous: la raison est, messieurs, une excellente chose - je vous l’accorde volontiers -, mais la raison n’est rien que la raison, elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l’homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière, oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de méninges. Et même si notre vie n’apparaît souvent pas très propre sous cet éclairage, elle est quand même la vie, et pas seulement une extraction de racine carrée. Moi, par exemple, je veux vivre, de façon absolument naturelle, pour satisfaire toute mon aptitude à vivre et non pour satisfaire seulement toutes mes aptitudes rationnelles, c’est-à-dire juste un vingtième, et encore, de toute mon aptitude à vivre. Que peut connaître la raison? La raison ne peut connaître que ce qu’elle a eu le temps d’apprendre (le reste, je crois, qu’elle ne le saura jamais; ce n’est peut-être pas une consolation, mais pourquoi ne pas le dire?), or la nature humaine fonctionne comme un tout, avec l’ensemble de ce qu’elle contient, conscient et inconscient, elle peut vous faire n’importe quoi, mais elle vit. Je soupçonne, messieurs, que vous me considérez avec de la compassion; vous me répétez qu’un homme civilisé, évolué, enfin, l’homme tel qu’il sera dans l’avenir, ne pourra désirer sciemment une chose qui lui serait néfaste, que cela est mathématique. Je suis parfaitement d’accord, c’est bien mathématique. Mais je vous répète pour la centième fois qu’il n’y a qu’un seul cas, oui, un seul cas, où l’homme peut délibérément, en toute conscience, se souhaiter quelque chose de néfaste, de stupide, et même le plus stupide qui soit, je veux dire: pour avoir le droit de se souhaiter même ce qui est le plus stupide, et ne pas être lié à cette obligation de se souhaiter toujours le plus intelligent. Parce que cette stupidité suprême, parce que ce caprice, en vérité, messieurs, peut-être arrive-t-il qu’il soit, en certains cas surtout, ce qui peut exister de mieux au monde. En particulier, il peut être le meilleur de tous les biens, même s’il se révèle évidemment nuisible et s’il vient contredire les conclusions les plus sensées de notre raison sur ce qui lui procure du bien, parce que, dans tous les cas, il nous conserve ce qui nous est le plus fondamental et le plus précieux, je veux dire notre personnalité, notre individualité. Certains affirment, n’est-ce pas, que c’est cela qui est le plus précieux pour l’homme; la volonté, si elle le veut, peut parfaitement, bien sûr, se fondre à la raison, surtout si l’on n’exagère pas cette raison, si l’on s’en sert avec modération; elle est une chose utile, et même, quelquefois, louable. Mais, très souvent, même la plupart du temps, la volonté lui reste obstinément irréductible et... et... vous savez quoi? Cela aussi, c’est très utile, et c’est parfois même très louable. Supposons, messieurs, que l’homme ne soit pas stupide. (C’est vrai, voilà une chose qu’on ne peut absolument pas dire de lui, ne serait-ce que pour cet argument: si l’homme est stupide, qui donc peut être intelligent?) Mais, s’il n’est pas stupide, il reste monstrueusement ingrat! Ingrat phénoménalement... Je pense même que la meilleure définition de l’homme est la suivante: créature bipède et ingrate. Et ce n’est pas tout encore; cela n’est pas son défaut principal; son défaut principal est sa mauvaise conduite perpétuelle, constante, depuis l’époque du déluge jusqu’à celle du Schleswig-Holstein des destins de l’humanité. La mauvaise conduite, donc, l’absence de raison; puisqu’il est établi depuis longtemps que le manque de raison provient de la mauvaise conduite. Essayez de jeter un oeil sur l’histoire de l’homme; que voyez-vous? Du grandiose? Je veux bien, du grandiose; rien que le colosse de Rhodes, par exemple, il se pose là! Le sieur Anaevski témoigne à juste titre du fait que les uns disent qu’il serait oeuvre humaine, quand d’autres affirment au contraire qu’il fut créé par la nature elle-même. Un paysage bariolé? Sans doute, le paysage est bariolé; il suffirait d’examiner à travers tous les siècles et chez tous les peuples ne serait-ce que les uniformes d’apparat, tant chez les militaires que chez les civils - eux aussi, ils se poseraient là, et, pour les uniformes de fonction, on s’y casserait les dents - aucun historien ne tiendrait le coup. De la monotonie? Mais oui, sans doute, de la monotonie; ils se battent et se battent encore, ils se battent encore aujourd’hui, ils se battaient avant, ils se battront plus tard - accordez-moi que c’est même un peu trop monotone. Bref, on peut dire ce qu’on veut de l’histoire du monde, tout ce qui peut venir à l’idée de la cervelle la plus dérangée. La seule chose qu’on ne puisse pas dire, c’est qu’elle est raisonnable. Vous vous contrediriez au premier mot. Et regardez un peu l’ennui qui vous arrive: car enfin, on voit paraître constamment devant nos yeux des hommes tout ce qu’il y a d’honnête et de raisonnable, des sages, des amis du genre humain, qui, justement, assignent pour but à toute leur existence de mener une vie aussi honnête et aussi raisonnable que possible, d’illuminer, pour ainsi dire, leur prochain avec eux-mêmes, pour lui prouver, au fond, qu’il est possible dans les faits de vivre sa vie d’une façon honnête et raisonnable. Eh bien? On le sait, beaucoup de ces amis du genre, un jour ou l’autre, à la fin de leur vie, se trahissent, et terminent par je ne sais quelles aventures, dont certaines sont même carrément malpolies. Maintenant, je vous demande: que pouvez-vous attendre de l’homme, s’il est une créature douée de qualités aussi bizarres? Mais couvez-le de tous les biens du monde, noyez-le dans le bonheur la tête la première, pour qu’il ne reste que des petites bulles à glouglouter à la surface de ce bonheur, comme sur une mare; donnez-lui une suffisance économique telle qu’il ne lui reste absolument plus rien à faire, sinon dormir, manger de la brioche et s’agiter, l’histoire du monde ne s’arrête pas - lui, l’homme, je veux dire, une seconde plus tard, par pure ingratitude, par pur désir de nuire, il vous fera une entourloupe. Il ira jusqu’à remettre sa brioche en jeu et se souhaitera, exprès, les bêtises les plus catastrophiques, la plus antiéconomique des absurdités, dans le seul but de mélanger à toute cette raison si positive son élément fantastique fatal. Oui, ce sont bien ses rêves fantastiques, c’est sa bêtise la plus crasse que l’homme voudra se conserver dans le seul but de se confirmer à lui-même (comme si cela était vraiment tellement indispensable) que les hommes sont encore des hommes, et pas des touches de piano, sur lesquelles jouent peut-être les propres mains des lois de la nature mais qui menacent, ces mains, de jouer au point qu’il sera interdit de vouloir hors des limites de l’almanach. Et, bien plus encore: même au cas où il serait vraiment une touche de piano, même si c’est là une chose qu’on lui démontre par les sciences naturelles et la mathématique, même là, il ne se rendra pas à cette raison, il fera sciemment quelque chose contre, par pure ingratitude; en fait, rien que pour s’obstiner. Et, s’il n’a plus de moyens, il inventera la destruction et le chaos, il inventera toutes sortes de souffrance, et il la soutiendra, sa position! Il lancera au monde sa malédiction, et, comme il n’y a que l’homme qui puisse maudire (ça, c’est son privilège, ce qui le distingue le plus fondamentalement des autres animaux), je gage qu’il atteindra son but avec sa seule malédiction, qu’il arrivera donc à se convaincre vraiment qu’il est un homme et pas une touche de piano! Si vous me dites que même cela, on peut le calculer sur des tablettes, même le chaos, la nuit et la malédiction, que c’est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout et que la raison reprendra le dessus, alors, l’homme fera exprès de devenir fou, pour perdre cette raison et s’obstiner dans son idée! Je suis sûr de cela, c’est une chose que je garantis parce qu’il me semble bien que toute l’activité humaine, vraiment, ne consiste qu’en cela que l’homme se prouve à chaque instant qu’il est un homme et pas une goupille d’orgue! Par ses plaies et ses bosses, mais qu’il le prouve; même en retournant dans les cavernes, mais qu’il le prouve. Après cela, comment ne pas pécher, ne pas se féliciter que tout cela n’existe pas encore, et que pour l’instant la volonté dépende encore de Dieu sait quoi...
Vous me criez (si seulement vous me faites encore l’honneur de me crier dessus) que personne ne me l’enlève, ma volonté; que tout ce qu’on essaie de faire ici, c’est d’arranger le monde de telle façon que la volonté, d’elle-même, par sa volonté propre, concorde avec mes intérêts normaux, avec les lois de la nature et de l’arithmétique.
- Voyons, messieurs, de quelle volonté propre pouvez-vous parler si nous en arrivons jusqu’aux tablettes et à l’arithmétique, s’il n’y a plus que deux fois deux font quatre qui fonctionne? Deux fois deux feront toujours quatre, que je le veuille ou non. C’est comme ça qu’elle existe, ma volonté? »
Autre traduction :
« La nature humaine veut agir par toutes ses forces, consciemment ou inconsciemment, artificiellement même, mais vitalement toujours. Je vous répète pour la centième fois qu’il y a un cas unique, mais certain – où l’homme veut se réserver le droit d’accomplir la plus sotte action et n’être pas obligé de ne faire que des choses bonnes et raisonnables. Car, à tout dire, c’est notre propre individualité qui est intéressée ici. »
Chapitre 9
« Messieurs, il y a des questions qui me torturent; résolvez-les pour moi. Vous, par exemple, vous voulez désapprendre aux hommes leurs vieilles habitudes et corriger leur volonté pour qu’elle corresponde aux exigences de la science et du bon sens. Mais comment savez-vous qu’il est non seulement possible mais nécessaire de transformer les hommes de cette façon? De quoi concluez-vous que la volonté humaine a une nécessité si impérieuse d’amendement? Bref, comment savez-vous qu’un tel amendement aura pour les hommes un intérêt réel? Et, tant qu’à dire ce qu’on pense, pourquoi êtes-vous certainement assurés que le fait de ne pas se dresser contre les intérêts normaux et véritables garantis par les conclusions de la science et de l’arithmétique soit pour les hommes réellement toujours profitable et forme une loi pour toute l’humanité? Car, pour l’instant, cela n’est que votre supposition. C’est une loi de la logique, je veux bien le supposer, mais pas du tout, peut-être, une loi de l’humanité. Vous pensez peut-être, messieurs, que je suis fou? Laissez-moi m’expliquer. Certes : l’homme est un animal essentiellement bâtisseur, condamné à tendre vers son but en toute conscience par la voie de l’ingénierie, c’est-à-dire à se frayer un chemin, à tout jamais et sans interruption, vers où que ce soit. Mais c’est pour cette raison, peut-être, qu’il a envie parfois de faire un détour, parce qu’il est condamné à se frayer ce chemin, et aussi, je suppose, parce que, si bête que puisse être en général l’homme d’action spontané, il lui arrive quand même de penser quelquefois que ce chemin, en fait, le mène presque toujours où que ce soit, que l’essentiel n’est pas de savoir où, mais le fait qu’il y aille, et que le gentil garçon, méprisant l’art de l’ingénierie, ne tombe pas dans la fatale oisiveté, laquelle, comme nous savons, est mère de tous les vices. Les hommes aiment bâtir et se tracer des chemins, d’accord. Mais pourquoi aiment-ils aussi passionnément la destruction et le chaos? Ça, dites-le-moi un peu. J’ai envie de déclarer deux mots moi-même à ce sujet. N’est-ce pas, peut-être que s’ils aiment tant la destruction et le chaos (et il est indéniable qu’il leur arrive d’aimer ça très fort, la chose est là), c’est qu’ils craignent eux-mêmes instinctivement d’atteindre leur but et d’achever le bâtiment qu’ils sont en train de construire? Qu’en savez-vous, peut-être, leur bâtiment, ils l’aiment seulement de loin, mais pas du tout de près; peut-être ce qu’ils aiment, c’est seulement le bâtir, mais pas vivre dedans, mais le laisser après aux animaux domestiques, du genre des fourmis, des moutons, etc. Les fourmis, elles, elles semblent d’un avis contraire. Elles possèdent un bâtiment stupéfiant du même genre, indestructible à tout jamais - la fourmilière.
Mesdames les fourmis ont commencé avec la fourmilière, elles finiront dans doute avec la fourmilière, ce qui fait honneur à leur constance et à leur caractère positif. Mais les hommes sont des créatures frivoles et pas jolies-jolies, et, comme le joueur d’échecs, peut-être, ils n’aiment que le processus qui mène au but, et non le but en tant que tel. Et, qui sait (on n’en jurerait pas), peut-être tout notre but en ce monde, ce but vers quoi l’humanité tend tellement, ne tient-il justement que dans le caractère continuel du processus de sa conquête, en d’autres mots - que dans la vie elle-même et non à proprement parler dans le but, lequel, cela est évident, ne doit être rien d’autre qu’un deux et deux font quatre, c’est-à-dire une formule, car deux et deux font quatre, ce n’est déjà plus la vie, messieurs, mais le début de la mort. Du moins les hommes ont-ils toujours eu peur, d’une façon ou d’une autre, de ce deux et deux, comme j’en ai peur moi-même à l’instant où j’écris. Supposons que les hommes ne fassent que rechercher ces deux et deux, qu’ils traversent les océans, qu’ils sacrifient leur vie dans cette recherche, mais - les trouver, les trouver pour de vrai, je vous le jure, ils en ont un peu peur. Ils sentent bien que dès qu’ils les auront trouvés, ils n’auront plus rien à chercher. Les ouvriers, à la fin de leur travail, reçoivent au moins de l’argent, ils peuvent faire un tour au bistro, se retrouver au poste - et voilà une semaine bien remplie. Mais les hommes, où peuvent-ils aller? Au moins, chaque fois, remarque-t-on chez eux comme un malaise quand ils atteignent ce genre de buts. Ils aiment l’action d’atteindre, mais, le fait même - ils ne l’aiment pas du tout, ce qui, bien sûr, est terriblement drôle. Bref, les hommes sont conçus d’une façon comique : il y a sans doute là comme une espèce de calembour. Mais deux et deux font quatre reste quand même résolument insupportable.Deux et deux font quatre, mais c’est, à mon avis, si je puis me permettre, un sarcasme pur et simple. Deux et deux se pavane comme un coq, se dresse au milieu de votre route, les mains sur les hanches, et reste là à vous cracher dessus. Je vous accorde que deux et deux est une chose excellente; mais tant qu’à tout louer, c’est deux et deux font cinq qui peut être un engin combien plus adorable.
D’où vient que vous êtes si fermement, si triomphalement persuadés que seuls le positif et le normal - bref, en un mot, le bien-être - sont dans les intérêts des hommes? Votre raison ne se trompe-t-elle pas dans ses conclusions? Et si les hommes n’aimaient pas seulement le bien-être? Et s’ils aimaient la souffrance exactement autant? Si la souffrance les intéressait tout autant que le bien-être? Les hommes l’aiment quelquefois, la souffrance, d’une façon terrible, passionnée, ça aussi, c’est un fait. Ce n’est même plus la peine de se rapporter à l’histoire du monde; posez-vous la question vous-même si seulement vous êtes un homme et si vous avez un tant soit peu vécu. Quant à mon opinion personnelle, aimer seulement le bien-être, ça me paraît presque indécent. Que ce soit bien ou mal, mais casser quelque chose, c’est parfois très plaisant. Car ce n’est pas la souffrance, au fond, que je défends ici, et pas non plus le bien-être. Ce que je défends, c’est... mon caprice, le fait qu’il me soit garanti quand j’en ressentirai le besoin. Par exemple, la souffrance est inadmissible dans les vaudevilles, je le sais. Dans le palais de cristal, elle est, de plus, impensable: la souffrance, c’est un doute, c’est une négation, or qu’est-ce qu’un palais de cristal où le doute est possible? Mais je reste persuadé que l’homme ne refusera jamais la souffrance véritable, c’est-à-dire la destruction et le chaos. Car la souffrance est la seule cause de la conscience. Même si j’ai commencé par affirmer que la conscience était pour les hommes leur plus grand malheur, je sais qu’ils l’aiment et ne l’échangeraient contre aucune satisfaction. La conscience est infiniment supérieure à deux et deux. Parce que, après deux et deux, cela s’entend, il ne reste non seulement plus rien à faire, mais plus rien à connaître. Tout ce qu’il est possible de faire alors, c’est de se boucher les cinq sens et de se plonger dans la contemplation. Bien sûr, la conscience vous amène au même résultat, c’est-à-dire que, là non plus, il n’y a plus rien à faire, mais on peut toujours se flageller de temps à autre, et ça vous ravigote un peu quand même. C’est vieux jeu, d’accord, mais c’est mieux que rien. »
Chapitre 10
Note perso : premier paragraphe en épitaphe. Cette métaphore à propos de « rester au sec », c’est la sécurité versus l’Aventure. Ce qu’il désire, c’est l’absolu quand bien même il serait inatteignable juste pour le plaisir de le désirer au-delà de la sécurité. C’est le résumé de ma vie ou de mon impossible quête de l’Amour -tel que je l’entends- et dont je suis malheureusement consciente. Le dernier paragraphe annonce l’absurde de Camus.
« Vous avez foi en un palais de cristal à jamais indestructible, c’est-à-dire quelque chose à quoi on ne pourra pas tirer la langue en douce ni dire mentalement « merde ». Et moi, peut-être, c’est pour cela que j’en ai peur, de cette construction, parce qu’elle est en cristal et à jamais indestructible, et qu’on ne peut même pas, en douce, lui tirer la langue.
Parce que, vous comprenez: si vous installiez un poulailler à la place du palais, au cas où il se mettrait à pleuvoir, je me glisserais même dans le poulailler pour ne pas être trempé, mais ma reconnaissance pour m’avoir protégé des gouttes ne me le fera pas prendre pour un palais. Vous riez, vous dites qu’un poulailler vaut bien le château de Versailles, en cas de pluie. Je vous réponds: Oui, si le seul but de la vie est de rester au sec.
Que faire si je me suis mis en tête qu’on ne vit pas que pour cela, et que, tant qu’à faire de vivre, autant vivre à Versailles? C’est cela, mon désir, c’est mon envie. Vous ne me l’effacerez de la cervelle qu’au moment où vous saurez me changer mes désirs. Eh bien, changez-les-moi, tentez-moi avec autre chose, donnez-moi un autre idéal. En attendant, je ne prendrai pas un poulailler pour un palais. Supposons même que le palais de cristal ne soit que du vent, que les lois de la nature l’interdisent et que je ne l’aie inventé que par suite de ma propre bêtise, à cause de certaines coutumes ancestrales irrationnelles de notre génération. Qu’est-ce que j’en ai faire, que la nature l’interdise? N’est-ce pas la même chose s’il existe dans mes désirs, ou, pour mieux dire, s’il existe tant que mes désirs existent?
Je gage que vous riez encore. Riez, je vous en prie; j’accepte toutes les moqueries, mais je ne dirai pas que je suis rassasié si j’ai le ventre creux; je sais quand même que je ne saurai pas me satisfaire d’un compromis, d’un zéro périodique constant, pour la seule raison qu’il existe selon les lois de la nature et qu’il existe en fait. Je ne prendrai pas pour le sommet de mes désirs un immeuble de rapport, avec des appartements pour les pauvres, des baux de mille ans et, on n’est jamais trop prudent, des Wagenheim sur une affichette. Anéantissez-moi mes désirs, effacez-moi mes idéaux, montrez-moi quelque chose de mieux et je vous suivrai. Je suppose que vous me répondez que je fais beaucoup d’histoires pour rien - auquel cas je vous réponds la même chose. Nous parlons sérieusement; si vous ne voulez pas me faire l’honneur de m’écouter, je ne vous retiens pas. J’ai mon sous-sol. Mais, tant que je suis vivant et que je désire - que ma main se dessèche si j’apporte une seule brique à un bâtiment de ce genre ! Oubliez ce que j’ai dit, tout à l’heure, quand je refusais le palais de cristal pour la seule raison qu’il était impossible de lui tirer la langue. Si j’ai dit ça, ce n’est pas du tout que j’aime tirer la langue. La seule chose, peut-être, qui me mettrait en rage, c’est que dans toutes vos constructions, jusqu’à présent, on n’en trouve pas, des palais où l’on puisse même ne pas tirer la langue. Non, je me la laisserais couper, cette langue, avec reconnaissance, s’il pouvait arriver que je n’aie moi-même plus jamais envie de la tirer. Qu’est-ce que j’en ai faire, si ce palais, on ne peut pas le construire, et qu’il faille bien nous contenter d’appartements? Pourquoi est-ce que je suis bâti de tels désirs? N’ai-je donc été bâti que pour parvenir à cette conclusion que toute ma construction n’est que du vent? Est-ce que vraiment c’est là le but? Je n’arrive pas à y croire.
Encore que, vous avez: je suis convaincu qu’il faut lui mettre le mors aux dents, à notre gars du sous-sol. Il est capable de se taire dans son sous-sol pendant quarante années, bien sûr, mais qu’il arrive à resurgir dans la lumière - il parle, il parle, il parle... »
Chapitre 11
Note perso : de la nécessité d’écrire pour croire soi-même au mensonge de sa conscience ; du but réel caché de cet écrit : un souvenir personnel douloureux « à décoller ».
« À la fin des fins, messieurs: mieux vaut ne rien faire du tout! Mieux vaut être inerte en toute conscience! Et donc, vive le sous-sol! J’ai eu beau affirmer que j’étais jaloux de l’homme normal jusqu’à la bile la plus noire - dans les conditions où je le vois, je ne veux pas devenir comme lui. (Même si je ne cesse pas d’être jaloux. Non, non - le sous-sol a quand même plus d’intérêt!) Là, au moins, il est possible... Eh là, mais là aussi je raconte n’importe quoi ! Je raconte n’importe quoi parce que je sais moi-même, comme deux et deux, que ce n’est pas le sous-sol qui est mieux, c’est quelque chose d’autre, quelque chose qui n’a rien à voir, et que je cherche tellement, et que je ne trouverai jamais! Au diable le sous-sol!
Mais voilà ce qui serait le mieux: si je croyais moi-même, un tout petit peu, à ce que j’ai écrit. Je vous jure, messieurs, il n’y a pas un mot, non, pas un seul, auquel je croie dans ce que je viens de gribouiller ! C’est-à-dire que j’y crois, et, en même temps, je crois que je n’y crois pas, je ne sais pour quelle raison, je sens et j’ai dans l’idée que je suis en train de mentir comme un bateleur de foire.
- Pourquoi avez-vous donc écrit tout ça? demandez-vous.
- Je vous enfermerais pour quarante ans, sans rien à faire, et je reviendrais vous voir quarante années plus tard, dans votre sous-sol, pour voir où vous en êtes... Est-il possible de laisser seul un homme sans rien à faire pendant quarante années?
- Et vous n’avez pas honte, et ça ne vous humilie pas? me direz-vous peut-être, en secouant la tête avec mépris. Vous avez soif de vivre et vous répondez vous-même aux questions essentielles avec votre logique de la confusion. Vos attaques sont tellement énervantes, tellement insolentes, et - en même temps - comme vous avez peur ! Vous dites n’importe quoi et vous en êtes satisfait; vous proférez des insolences, vous tremblez perpétuellement de ce que vous dites, et vous demandez pardon. Vous assurez que vous n’avez peur de rien, et, en même temps, vous essayez de vous grandir devant nous. Vous assurez que vous grincez des dents, et, en même temps, vous plaisantez pour nous faire rire. Vous savez que vos bons mots ne sont pas drôles, mais il est clair que vous êtes heureux de leur qualité littéraire. Peut-être est-ce vrai que vous avez souffert, mais vous n’éprouvez pas le moindre respect pour votre souffrance. Vous détenez une vérité, mais vous n’avez pas la moindre pudeur; c’est la gloriole la plus mesquine qui vous fait exhiber votre vérité devant tout le monde, au pilori, à la foire... Oui, vous voulez dire quelque chose, mais votre peur vous fait cacher votre dernier mot car vous n’avez pas assez de cran pour lui trouver une expression, vous n’êtes mû que par une insolence lâche. Vous vous flattez de votre conscience, mais vous ne faites qu’hésiter, car même s’il est vrai que votre esprit travaille, votre cœur est noirci par la dépravation et, sans un cœur pur, une conscience pleine et juste est inimaginable. Et comme vous êtes énervant, que vous êtes collant avec toutes vos grimaces ! Mensonge, mensonge et encore mensonge!
Evidemment, ce que vous me dites là, je viens de l’inventer. C’est toujours le sous-sol. Pendant quarante années j’ai écouté ce genre de discours derrière la porte. Je les inventés moi-même, il n’y avait que ça qui se laissait inventer. Pas étonnant que ça se soit appris par cœur, et que ça me fasse de la littérature…
Enfin, est-ce que vraiment, vraiment, vous pensez que j’ai à ce point une cervelle d’oiseau pour imaginer que tout cela, je le publierai et que je vous le donnerai à lire? Encore une chose qui m’étonne: c’est vrai, pourquoi est-ce que vous appelle « messieurs », pourquoi est-ce que je m’adresse à vous comme si, vraiment, je m’adressais à des lecteurs ? Les oeuvres du genre de celle que j’ai l’intention d’écrire, on ne les publie pas, on ne les montre à personne. Du moins n’ai-je pas assez de force en moi - et je ne pense pas qu’il faille que j’en aie. Mais, voyez-vous: une fantaisie m’est entrée dans la tête, et je veux la réaliser quoi qu’il m’en coûte. Voilà de quoi il s’agit.
Il y a dans les souvenirs de chacun des chose qu’il ne révèle pas à tout le monde, mais seulement à des amis. Il y a des choses qu’il ne révélera pas même à ses amis, mais seulement à sa propre conscience, et encore - sous le sceau du secret. Et il y a enfin des choses que les hommes craindront de révéler même à leur propre conscience, et ces choses, même chez les hommes les meilleurs, il y en a une quantité qui s’accumule. On pourrait l’énoncer ainsi: plus les hommes sont honnêtes, plus il y en a. Au moins, moi-même, n’ai-je décidé que récemment de me rappeler certaines de mes aventures - jusqu’à présent, je les avais toujours contournées, avec, même, une inquiétude bien réelle. Maintenant, non seulement je me les rappelle mais j’ai encore décidé de les écrire, et c’est cela que je veux essayer: est-il possible d’être entièrement sincère - ne fût-ce qu’avec sa propre conscience - et d’affronter toute la vérité? Une parenthèse: Heine affirme que les autobiographies fidèles sont presque impossibles car il est presque sûr qu’on se mentira à soi-même. Il pense, par exemple, que Rousseau a menti dans sa confession, et qu’il a même menti sciemment, par vanité. Je suis sûr que Heine a raison; je comprends très bien qu’on puisse s’accuser de tous les péchés du monde par simple vanité, et je conçois parfaitement quel genre de vanité cela peut être. Mais Heine parlait d’un homme qui faisait une confession publique. Moi, je n’écris que pour moi seul et je déclare une fois pour toutes que même si j’écris en ayant l’air de m’adresser à des lecteurs, c’est seulement pour faire bien, parce que c’est plus facile. Ce n’est là qu’une forme, une pure forme vide, je n’aurai jamais de lecteurs. Je l’ai déjà déclaré...
Je veux que rien ne vienne me gêner dans l’écriture de mes carnets. Je n’établirai ni ordre ni système. Ce qui me reviendra en mémoire, je le noterai.
Tenez, par exemple: vous auriez pu pinailler sur le mot et me demander: s’il est vrai que vous ne comptez pas avoir de lecteurs, pourquoi vous faites-vous de telles remarques - et par écrit, encore! - comme quoi vous n’établirez ni ordre ni système, vous notera ce qui vous reviendra, etc. ? Pourquoi toutes ces explications? A quoi bon ces excuses?
- Ah, mais précisément! vous dis-je.
Remarquez, il y a là toute une psychologie... Peut-être le fait que je suis simplement un lâche. Peut-être aussi le fait que si je m’imagine devant un public, c’est pour me tenir un peu plus décemment pendant que j’écrirai. Des raisons, on en trouverait mille.
Et cela, encore: au fond, pourquoi diable est-ce que je veux écrire? Si ce n’est pas pour le public, on pourrait croire qu’il suffirait de se souvenir mentalement, sans rien traduire sur le papier.
Bien sûr, messieurs: seulement, sur le papier, cela prendra un air plus solennel. Il y aura là je ne sais quoi de plus imposant, mon propre tribunal sera plus fort, j’améliorerai mon style. Et puis: peut-être le fait d’écrire m’apportera-t-il un soulagement. Ces jours-ci, par exemple, il y a un vieux souvenir qui m’oppresse entre tous. Je m’en suis souvenu en détail il y a quelques jours et il ne me quitte plus depuis, comme un air de musique affligeant qui ne veut plus se décoller de vous. Il faudra bien qu’il se décolle, pourtant. Des souvenirs comme celui-là j’en ai des centaines; sauf que, parfois, dans cette centaine, il y en a un qui se dégage et qui m’oppresse. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que si je le transcris, il va se décoller. Pourquoi ne pas essayer?
Enfin: je m’ennuie, je ne fais rien à longueur de journée. Ecrire, c’est comme si c’était du travail. On dit que le travail vous rend honnête et bon. Eh bien, voici au moins une chance.
Il neige en ce moment, c’est une neige mouillée, jaune, glauque. Hier, c’était pareil - c’était pareil les jours d’avant. C’est cette neige mouillée, je crois, qui m’a rappelé cette anecdote qui refuse maintenant de se décoller de moi. Que mon récit soit donc sur la neige mouillée.
Autre traduction :
« Il n’y a rien de mieux au monde qu’une inertie consciente. Vive donc le souterrain !
Ah ! pourquoi en suis-je jamais sorti ? Pourquoi n’y suis-je pas né ? – Car j’ai voulu essayer de vivre, je vous l’ai dit : j’ai essayé d’être goujat. – Peut-être même ai-je aussi essayé d’être héros. Rien, il n’y a rien dans le monde pour moi. Mon passé est une perpétuelle et ironique négation. Hélas ! j’ai rêvé, je n’ai pas vécu ! et pourtant je vais bientôt mourir. De cela je ne me plains pas trop. Pourtant, messieurs, avouez vous-mêmes que ce n’est pas juste !
J’ai rêvé la vie au loin, sur les bords de la mère Volga, avec la si belle, la si étrange fille, dont je n’ai pas eu la force de m’emparer quand elle m’était offerte, elle ma vraie vie, ma seule vie, et depuis ce jour-là je suis mort avant la mort, tué par une apparition farouche, une ombre de vieux satyre qui n’a peut-être jamais existé, et je disserte…
Je vous jure, messieurs, que je ne crois pas un traître mot de tout ce que je viens d’écrire, – c’est-à-dire, peut-être bien au contraire j’y crois très-vivement, – et pourtant quelque chose me dit que je mens comme un cordonnier.
– Pourquoi donc avez-vous écrit tout cela ?
– Je voudrais bien, messieurs, vous voir condamnés à quarante ans de néant, et je voudrais bien ensuite savoir ce que vous seriez devenus !
– Imaginez un peu cela, je vous prie : vous n’avez pas eu d’existence réelle, et dans un caveau où ne pénètre qu’une lumière de crépuscule finissant, une aube d’agonie, vous vous demandez ce que c’est que la vie, et ce que c’est que le jour. Je vous ai donné quarante ans pour vous faire une opinion sur ces graves sujets, et aujourd’hui, premier jour de la quarante et unième année, je vous interroge : « Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce que… ? » Mais vous ne me laissez pas finir. Vous avez tant pensé, tant réfléchi, que vous éclatez en paroles, un peu incohérentes, mais non pas tout à fait dénuées d’un certain sens commun »
Extrait de: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. « L'Esprit Souterrain. » iBooks.
 |
| « Conscience:Judas », de Nikolaï Gay, 1891 (peintre évoqué par Dostoïevski). |
Conclusion perso : cette première partie m'a fait aimer le narrateur parce que je m'identifie à nombreux de ses propos et j'aime l'originalité de sa pensée mais la deuxième partie intitulée "Sur la neige mouillée", où il décrit avec une précision chirurgicale son fonctionnement interne écoeurant de pervers narcissique dégoûte définitivement du personnage.